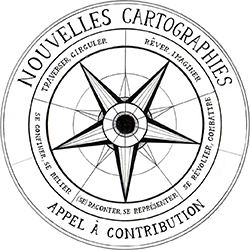© Julien Pitinome – Collectif OEIL
EX VOTO
Lettre d’Aurore à son amie Mamie Wata
par Nathalie M’Dela Mounier
Ma sœur-amie,
« Alors, on dit quoi ? » Cela fait si longtemps que tu ne m’as pas posé cette question avec un ton mutin, Mamie Wata. Et je sais que ce surnom t’agace un peu, mais pour ta protection, tu dois rester anonyme, tout comme moi (mais je sais que tu me reconnaîtras). Cette figure emblématique me rappelle la femme puissante que tu es et, à travers toi, je m’adresse à mes autres sœurs africaines.
Tes mots me manquent. J’ai moi-même reporté la rédaction de cette lettre plusieurs fois. C’était impossible de te joindre et, pour être honnête, impossible d’écrire. Je ne pouvais plus coucher les mots sur le papier, comme on dit, je les jetais brutalement, tels des dés, après avoir formulé une petite incantation en souhaitant que de nouveau ils veuillent signifier quelque chose et te parviennent de l’autre côté de l’eau.
Un jour, tu m’as demandé : Comment en sommes-nous arrivés là ? C’était une question rhétorique car depuis des années tu analysais et décortiquais causes et conséquences des dysfonctionnements de ce monde pour les proposer à la compréhension. Tu pratiquais sans relâche l’exercice de la réflexion et du débat, envisageais des changements pour un ordre plus équitable et faisais poliment mais impitoyablement la nique à ceux qui orchestrent le chaos.
Aujourd’hui, je ne cesse de m’interroger en regardant autour de moi, en écoutant le silence inhabituel se fracasser sur la porte de ma maison : Comment en sommes-nous arrivés là ? Et moi, quelle est ma part, ma place dans ce désastre ?
Je ne t’ai jamais raconté que, lorsque j’étais enfant, j’avais demandé à mes parents pourquoi ils m’avaient choisi ce prénom, Aurore, que mes camarades de classe détournaient en m’appelant Horreur. Longtemps ils m’ont rassurée en argumentant que j’avais la chance de porter le prénom de la Belle au bois dormant. Comme j’étais gavée de contes issus de nos différentes cultures et riche d’une imagination fertile, j’ai supposé qu’un jour je me réveillerais sous les lèvres pulpeuses d’un prince qui a pris le visage de Ti Jean puis celui de tous mes petits amoureux de l’époque. J’étais certaine de détenir un secret échappant aux abrutis qui hantaient la cour de récréation en me persécutant de leurs sarcasmes. Et puis je me suis brutalement réveillée du sommeil de l’âge tendre, reniant mes rêves puérils quand j’ai découvert Électre de Giraudoux dans la bibliothèque familiale. Le livre était corné à la dernière page, inhabituel car chez nous les livres étaient quasi sacrés, cela m’a intriguée. C’est alors que j’ai grandi d’un coup en lisant ces phrases qui ont abrégé mon enfance :
« – Comment cela s’appelle-t-il, quand le jour se lève, comme aujourd’hui, et que tout est gâché, que tout est saccagé, et que l’air pourtant se respire, et qu’on a tout perdu, que la ville brûle, que les innocents s’entre-tuent, mais que les coupables agonisent, dans un coin du jour qui se lève ?
– Cela a un très beau nom, femme Narsès. Cela s’appelle l’aurore. »
J’ai regardé autour de moi, arpenté lieux et non-lieux, rencontré les innocents coupables, documenté l’enfermement, l’empêchement, les crimes de lèse-humanité, labouré à la fois les friches de l’intime et du politique. Et opté pour mon deuxième prénom, celui que tu connais, incapable d’assumer la charge symbolique du premier. Cependant, j’ai tenté de ne pas plier ni rompre non plus, de sortir du recroquevillement, de l’abattement, de l’impuissance, pour m’étirer et tenir ma conscience éveillée. C’est vrai, tu m’as maintes fois incitée à sortir de ma zone de confort, à oser. Et à marronner, marronner, marronner dans tous les mornes qui s’offraient.
Alors, t’écrire est un peu mon dernier rempart contre la folie. Pas la mienne, celle du dehors. Moi, ça va. Curieusement, ça va même plutôt bien. J’essaie de me rappeler comment tout cela a commencé pour éviter de penser à comment ça pourrait se finir…
Au début.
Il y a un an.
Tout juste un an. Juste au moment où je devais venir te rejoindre en ton chez-toi qui est aussi un peu le mien puisque je suis aussi africaine – canal historique ! C’était peu de temps après l’arrivée d’un virus dont on nous avait d’abord dit que nous ne craignions rien. On nous avait simplement demandé de faire attention, nous avions un peu le droit de sortir avec des autorisations, puis plus le droit du tout. Enfermés chez nous ! On n’a rapidement même plus eu le droit de profiter du jardin qui s’ensauvageait tranquillement, mais moi, je ne ratais pas une heure bleue sur le pas de la porte, veillant à rester invisible des objets métalliques griffant le ciel pour nous espionner et délivrer des messages agressifs de leurs voix atones.
Au début, c’était l’affaire de quelques semaines, puis dix et les mois se sont enchaînés sans que nous comprenions comment ni pourquoi. Les oiseaux, après avoir longtemps déserté les cieux, étaient revenus caresser les nuages et leurs piaillements nous étourdissaient en nous enchantant. Nous n’avions pas vraiment peur. Au début. Avant que le silence ne devienne menaçant et que le danger plane au-dessus de nous, pas identifiable et que les drones ne vrombissent en décollant brutalement à la verticale de nos inquiétudes. Le grand confinement, ils ont appelé cela.
Au début, nous ne portions pas de masques, c’était inutile, voire dangereux, puis ils sont devenus obligatoires et comme nous n’en trouvions pas, nous en avons cousu : dans du tissu vichy, du madras, du wax, dans nos coupons en stock, des serviettes de plage qui ne connaîtraient plus le sable. Puis nous en avons taillé dans de l’austère cotonnade blanche customisée au gré de nos humeurs, sourire, moue énigmatique, cri de colère. Nous nous voulions semblables à l’autre avec lequel nous nous confondions tout en le tenant très à distance, nous sommes devenus des porteurs de masques en écho à l’hypocrisie étatique qui nous dictait sa loi. Puis ça a cessé de nous amuser ; nos visages eux-mêmes sont devenus des masques figés, neutres, sans expression, empreints de l’intense désarroi que nous ressentions. Puis nous n’avons plus rencontré personne. Exit les masques…
Au début, nous recevions notre salaire en télétravaillant, puis nous n’avons plus pu travailler et nos paies ont cessé d’être versées, juste une aide d’État sous la forme de colis alimentaires livrés à notre porte une fois par mois par des silhouettes blanches gantées et masquées que nous devinions plus que nous les voyions. L’autre était effacé quand la menace s’est affirmée.
Au début, nous faisions sérieusement de la gymnastique ou dansions inlassablement devant nos miroirs, et nous échangions par vidéos les tuyaux pour maintenir notre forme. Puis nous avons commencé à nous en moquer, à regarder nos bourrelets graisseux se former au gré de notre lassitude, nos ongles et nos cheveux pousser, notre peau se dessécher à force d’être trop lavée puis plus lavée du tout.
Au début, la télévision regorgeait d’informations, d’images chocs, de grandes déclarations, d’éditions spéciales finissant par devenir la norme et n’avoir plus rien de spécial. Puis vint le défilé des chiffres, ceux des testés, des contaminés, des décédés, des présumés guéris, des incarcérés, des disparus, puis plus de chiffres du tout. Et les chaînes se sont éteintes les unes après les autres, ne laissant la place qu’à une seule qui fonctionnait vingt quatre heures sur vingt-quatre. Non, deux en fait. Sur la première chaîne, juste une succession de séries guimauve qui avaient remplacé les programmes d’actualités. Des blondes peroxydées accompagnées de jules bodybuildés y ont pris la place des experts, des politiques, des animateurs télé plongés dans un grand coma médiatique. Leur rôle ? Absorber le silence. Sur la deuxième chaîne, des séries de plans-séquences diffusés de manière aléatoire : un feu de cheminée crépitant, un bocal de poissons tropicaux tournant en rond, des vagues se cassant sur des falaises, le vent sifflant dans des saules, des papillons volant au-dessus de la canopée, la neige tombant inlassablement sur un paysage montagneux. Leur rôle ? Combler le vide. Notre temps de cerveau disponible est devenu infini.
Au début, nous surfions sur le web comme des malades, prenant les vagues de nouvelles alarmantes de plein fouet, essayant de rester en équilibre sur la frange des rouleaux qui nous brassaient en tous sens, passant dans de longs tunnels dont nous émergions éreintés pour nous ébrouer devant nos claviers. Certains de comprendre. Certains de bien faire. Et puis, les connexions se sont faites difficiles, presque impossibles, juste une fois par jour, alors nous avons privilégié l’apéro-web avec des amis, puis quand les bouteilles et les regards se sont vidés, les écrans se sont figés.
Au début, tu sais, je n’étais pas seule. Mon compagnon de toujours, oui, celui que tu connais, était confiné avec moi et c’était plutôt sympa, finalement. Puis c’est devenu moins sympa. Les rouges- gorges qui habitaient son âme se sont transformés en vautours fauves et se sont mis à voler dangereusement autour de nous. Bruits hachés d’ailes, de coups de bec, de proies couinant avalées dans des sanglots, désespoir dénié et vorace. Et un soir, le dixième mois, je crois, juste avant l’aube, il a ouvert la porte, franchi le seuil et l’interdit, soigneusement refermé la porte derrière lui après m’avoir envoyé un dernier baiser. Et je ne l’ai pas revu. Avalé par le bleu profond, mon charmant prince des ténèbres, il a rejoint la cohorte des disparus dont personne ne parle jamais mais dont nous avons pourtant tous entendu parler. Pourtant je sais que quelque part son cœur continue de battre.
Au début, on nous parlait de ces cohortes menaçantes de migrants prêts à envahir nos villes et nos campagnes, des jungles où ils s’abritaient, des mers où sombraient ces voyageurs dont nul ne disait le courage. Puis, une violence succédant à l’autre, on n’a plus entendu parler de ces exilés qui cognaient à la porte de l’Europe, plus évoqué leurs situations invivables, le risque de recevoir des terroristes présumés, les délinquants en herbe folle semé sur notre sol. Alors, quoi ? Tous bien sagement chez eux enracinés dans leur misère forcément noire ? Tous noyés ? Tous ensablés ? Tous ensevelis dans les charniers de la mémoire ? De refoulement en évacuation, ils sont devenus encore plus transparents, totalement invisibles, dissous dans nos acides rancœurs. Puis plus le temps d’y penser, ils ont cessé d’être nommés et d’exister. Pourtant je sais que quelque part leur cœur continue de battre.
Au début, on nous parlait de cette pauvre Afrique qui allait encore trinquer, forcément ! Chroniques d’un massacre annoncé, une catastrophe épouvantable et forcément irrémédiable, une évolution qui serait tragiiiiique, une ultime humiliation pour ce continent perdu, définitivement pas à la hauteur et qui allait encore une fois démériter. Le monde s’apprêtait à orchestrer ses remontrances et son mépris, à verser de nouvelles larmes de crocodile sur ton continent, ma sœur-amie, sur ses incapacités à anticiper et réagir, sur le désastre qui allait encore coûter cher à l’Europe forcément triomphante et qui aura tellement souffert ! Et puis des commentateurs ont fait état de la réactivité des États africains, du peu de cas graves constatés. Ils ont évoqué la bonne gestion sanitaire, c’est devenu impossible de geindre sur les malheurs supposés de l’Afrique, continent maudit, sur la mauvaise gouvernance, sur ses incapacités chroniques. Certains ont fini par en déduire que face à cette calamité les États faillis étaient occidentaux, que l’opulence ne préservait de rien, que la peur avait changé de camp comme le cataclysme annoncé de destinataire. Tu imagines que bien des dents ont grincé ! Alors, avant que certains ne décident de prendre l’Afrique comme modèle (on ne sait jamais !), de montrer que ses experts n’ont rien à envier ni à ceux du Vieux Continent ni au Nouveau, que le chaos n’est pas inscrit dans ses gènes, que la peau noire n’est pas une malédiction, que cette fois les Africains avaient une chance de mieux s’en sortir, et que non seulement ils allaient s’en sortir seuls mais qu’ils finiraient par proposer leur aide, oui, avant d’en arriver là, l’Afrique a tout simplement disparu de nos écrans, avalée par le néant médiatique, remplacée un temps par l’Amérique latine, ses charniers et ses larmes jusqu’à ce qu’elle commence à relever la tête et ne soit remplacée par… rien du tout. La mire à quadrillage sans aucun son pour les décérébrés qu’on voudrait que nous soyons. Mais je sais que le cœur de l’Afrique continue de battre.
Au début, nous étions impatients, puis patients, attentifs, attentistes puis complètement passifs. Tout est devenu urgent, et l’état d’urgence est venu ; c’est là que tout s’est mis à débloquer. Parce qu’au début nous pensions qu’il y allait avoir une fin, nous préparions l’après, avant d’admettre que ça allait durer longtemps, peut-être toujours, puis, nous n’avons plus utilisé ce mot : Après. T’écrire, c’est invoquer la puissance de l’amitié, ma sœur en humanité ; ma raison s’accroche et mes pensées s’étirent. Et ça me donne force et courage. Car c’est décidé ; même si c’est interdit, je pars. On ne m’assignera pas à résidence, ni ici, ni là-bas, ni dans des entre-deux illusoires, charniers féconds. J’irai femme-banyan aux racines rhizomiques. Ne t’inquiète pas, mon amie, je veux saisir l’heure bleue. Je vais voir ailleurs si nous sommes encore. Je vais oser m’affranchir des peurs pour affronter les innocents monstres qui hantent l’inconnu. Mais je ne fermerai pas à clé de crainte qu’un hôte s’invite en mon absence et ne se heurte à la porte close ; mon compagnon, s’ils n’ont pas eu sa peau ; toi, peut-être, si tu me cherches ! Non, ne t’inquiète pas, ça va aller, ça va déjà. Aucun volatile fou ne s’est invité dans ma tête, pas d’ombres dévorantes, pas de guiablesses, pas d’Iblis faussement angélique, pas d’oiseaux de bon ni mauvais augure, pas de kommolo tebu aux ailes étendues planant vers l’infini. Tout va bien. Je vais essayer de trouver à poster cette lettre et si tu la reçois, petit quimbois, c’est donc que tout est possible ! Alors, si c’est le cas, réponds-moi, ma sœur-amie, toi qui es mémoire vive et épine dans la chair oublieuse.
Tu me manques tant !
Aurore
Lettre d’Aurore (Europe de l’Ouest) à son amie Mamie Wata (Afrique de l’Ouest), mai 2021
PS : J’ajoute rapidement un petit mot au moment de sceller mon enveloppe, car j’ai trouvé un moyen de te la faire parvenir. Je dispose de peu de temps, mais quand nous nous verrons, je te conterai tout ! Il n’y a plus de poste, effectivement, mais des « femmes-courrier » se chargent de nos missives et vont les porter en toute illégalité dans ce qui reste du monde dont elles nous donnent aussi les dernières nouvelles. Le grand-monde grouille de vie loin de nos yeux bandés. C’est fascinant ! En fait, dans le petit-dehors, une paix factice règne, pas un passant, pas un rire d’enfant, un pays mort-vivant sans ti moun et confit dans sa peur. Seuls des militaires suréquipés demeurent menaçants à chaque carrefour, défiés par les animaux sortis des campagnes pour coloniser les villes et qu’ils tirent quand l’ennui les prend. Hallucinant ! Mais il y a aussi dans les lisières urbaines une foule interlope et généreuse qui résiste avec une grande détermination. En bref, on dit que celles et ceux qui sont attrapés dans les rues vont rejoindre les grandes usines qui alimentent l’économie de guerre et n’en ressortent jamais ; pour quels « crimes » ? Avoir fait l’éloge du baiser et de la caresse, être réfractaires à l’éviction sociale venue après la distanciation, oser penser, douter, s’éveiller, se rebeller contre l’ordre imbécile, être une femme, un homme dressé ; on dit que personne n’a été malade depuis bien longtemps, que les hôpitaux sont vides, les prisons pleines pour alimenter leurs fichues usines, que le virus a disparu mais que la démocratie a payé le prix fort, trouvée agonisante au détour des mensonges ; on dit que tout n’est pas perdu et qu’il est toujours possible de prendre la mer pour se rendre sur ton continent – « espoir-pas-mort » est le slogan inscrit à la proue des bateaux dédiés à ce voyage ; on dit qu’en Afrique les guerres de convoitise sont terminées, que plus personne ne vient piller son sous-sol, tuer, enlever ou tenter de soumettre ses enfants, que le Sahel recule et que les cultivateurs, sur leurs terres moins arides, ont recommencé à nourrir les populations, que les femmes sont toujours debout et que leurs pagnes colorés ne sont plus recouverts de slogans à la gloire de futurs élus ; on dit d’ailleurs qu’il n’y a plus de bétail électoral à conduire à l’abattoir ; on dit que le fleuve Djoliba est de nouveau gros de ses eaux, que les pêcheurs pêchent, que les chasseurs chassent et que les hommes ont cessé de se pourchasser au nom de fausses certitudes ; on dit que les masques sortent de nouveau et plus seulement pour les funérailles, que les échasses arpentent le continent où la paix et la sécurité règnent ; on dit que c’est la Terre promise, le Paradis, le nouveau Mbeng – je te vois sourire derrière ta main… On dit que nous sommes les bienvenus ; on dit tant de choses ! Qu’importe ce qu’on dit, car même si une part infime est vraie, je suis désormais déterminée à te retrouver, sûre que ton ombre portée de sirène puissante me protégera pendant ce trajet ; la légitimité de mon marronnage est évidente tout comme notre communauté de destins. J’embarquerai au plus vite, mais qui sait quand j’arriverai ? Peu importe, ma sœur, pense à moi chaque fois que viendra l’apaisante heure bleue et que le jour succombera à la hache de ta douce nuit africaine. Toi immobile, moi en marche, nous ferons ainsi un voyage intérieur, un invoyage qui tracera les routes d’un monde réinventé sans gestes frontières, débarrassé de certaines de ses peurs et de certains de ses préjugés. Avant de reconnaître le bruit de mes semelles usées, de deviner mon corps épuisé dans l’encadrement de ta porte, de sourire au « Ko, ko, ko » qui précédera notre étreinte, entends mon cœur battre à l’unisson du tien, où qu’il soit. Attends-moi chaque jour, à l’heure indigo, debout, là où naissent les routes. Je suis en chemin, tu es au bout du chemin, nous sommes le chemin.