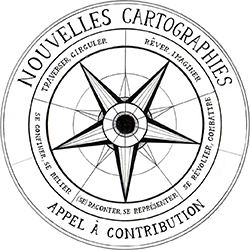Flora Beillouin
Les « chicanos » utilisent parfois cette formule poétique qu’on peut lire sur les T-shirts et sur les murs de Los Angeles : « Ce n’est pas moi qui ai traversé la frontière, c’est la Frontière qui m’a traversé.e. » Parce qu’on a toutes et tous, des histoires de passages de frontières, réelles ou symboliques, qui nous ont marqué.e.s.
Le jour où la frontière m’a traversé.e
…entre le Guatemala et le Mexique.
par Flora Beillouin
C’était en août 2015. Avec Cécile, une amie journaliste, nous nous apprêtions à faire un reportage sur le durcissement de la frontière qui sépare le Guatemala du Mexique. Cette frontière est un goulot d’étranglement particulièrement dangereux pour ceux qui cherchent à fuir la violence du narcotrafic qui mine les pays d’Amérique centrale. La plupart d’entre eux sont prêts à tout pour atteindre les États-Unis.

Un Salvadorien, rencontré plus tard dans un refuge à Oaxaca, nous a même raconté qu’il avait tenté le coup à sept reprises, sans jamais se décourager. Nous avons quitté Antigua au petit matin dans l’objectif d’atteindre le Mexique avant la nuit. Au Guatemala, à part les circuits touristiques qui sont desservis par des navettes haut de gamme, les transports quotidiens se font dans ce qu’on appelle les « chicken bus ». Des bus hors d’âge aux couleurs vives dans lesquels s’entassent hommes, femmes et enfants, et dont les chauffeurs ignorent tout du code de la route. Le toit croulant sous les marchandises et les bagages, ils foncent à toute allure dans les virages de montagne en klaxonnant au cas où ils croiseraient d’autres véhicules. Il n’est pas rare de croiser un ou deux macchabées sur le bord de la route.
C’est dans le chaos d’une de ces gares routières dominées par les chiens errants et l’odeur d’urine que notre périple a commencé. Vite interrompu, puisqu’au bout d’une heure de route, le chauffeur s’est arrêté pour déjeuner sur la place du marché d’un petit village. Au cours de son interminable pause, des vendeurs ambulants se sont succédé sans trêve. Une situation visiblement familière pour les passagers, puisque tout le monde achetait de quoi grignoter ou se rafraîchir avec une patience à toute épreuve.
Lorsqu’il a repris le volant, le chauffeur a redémarré en trombe sans regarder sur sa gauche, heurtant un autre bus qui s’apprêtait à le doubler. Il a continué comme si de rien n’était mais l’autre l’a immobilisé en lui faisant une queue de poisson, l’obligeant à descendre. La tension est montée d’un cran entre les deux hommes et une patrouille de flics est intervenue, commençant à tabasser tout le monde, passants compris. Les passagers ont alors commencé à déserter le bus. Comme nous ignorions tout de notre position géographique, nous sommes restées à bord.
Une heure plus tard, nous sommes repartis sans plus d’explications. Le bus s’est de nouveau rempli, puis il a stoppé net. Des militaires surarmés ont commencé leurs allées et venues, contrôlant sans un mot l’identité de tous les passagers, puis certains sacs. Quelques kilomètres plus loin, le chauffeur, passablement amoché, nous a jetés brutalement sur le bord de la route avec nos bagages, nous disant qu’il ne pouvait pas continuer, mais qu’un mini-bus prendrait la relève jusqu’à la frontière.
Le minibus a fini par arriver, plein à craquer. Nous nous sommes entassées près d’une famille nombreuse dont la mère a commencé à nous aborder. Elle nous offrait à manger, nous adressait de grands sourires et insistait pour qu’on franchisse avec elle le poste frontière. Nous ne comprenions pas en quoi nous pouvions l’aider à passer mais son attitude commençait à nous mettre mal à l’aise. Aussi, lorsque nous avons fini par arriver au village-frontière, nous nous sommes empressées de la semer en nous engouffrant dans un café.
Accablées par le stress et la chaleur épaisse, nous avons commandé un coca puis nous sommes assises sous le ventilateur le temps d’évaluer la situation. Non seulement nous étions les seules blanches à sac-à-dos à la ronde, mais nous étions aussi les seules à nous balader sans flingue à la ceinture.
Pour atteindre la frontière, il fallait traverser le village à pied. Tout, alentour, avait des allures de Far West, et nous étions tellement flippées que nous avons accepté, une fois n’est pas coutume, les services d’un bici-taxi. Pourquoi celui-ci nous avait inspiré davantage confiance que les dix autres qui se disputaient avec lui le prix de la course ? Va savoir ce que te dicte ton instinct dans ce genre de cas. Une chose était sûre, nous avions fait le bon choix. Vu la manière dont les âmes errantes de ce village nous mataient, comme des bêtes curieuses ou des proies potentielles, nous aurions pris davantage de risques à pied.
Le bici-taxi nous a déposées devant un immense pont métallique qui enjambait des bidonvilles amoncelés aux abords du fleuve. Nous apercevions le poste frontière, minuscule, de l’autre côté. Déjà, le ciel prenait des tonalités roses et orangées. Le crépuscule n’allait plus tarder. Nous avons payé le type et nous sommes avancées sur le pont.
En bas, nous pouvions voir les clandestins et les passeurs qui les faisaient traverser sur des radeaux de pneus couverts de sacs. C’était surréaliste. Nous, en haut, rongées par la peur de cet environnement hostile, eux, en bas, dont c’était le quotidien. Que risquions-nous au juste ? Eux n’avaient plus rien à perdre. Ils étaient prêts à s’exposer avec certitude aux arrestations musclées de la police aux frontières, aux barbelés incisifs, aux morsures des chiens, aux viols, aux arnaques des passeurs, et pire : aux enlèvements perpétrés par les cartels rôdant à proximité des zones de passage, qui se servent des réfugiés pour leur faire exécuter les basses besognes.
Nous sommes enfin arrivées au poste et le mec du guichet a eu l’air a la fois surpris et réjoui de voir nos dégaines de touristes. Il a eu un sourire lubrique. Évidemment dans ce pays, les tampons qui valident l’entrée et la sortie du territoire ne sont pas gratuits. Le prix est à la gueule du client. Nous nous en sommes tirées pour 40 quetzals. Puis le mec nous a indiqué le sas de contrôle des bagages, qui jouxtait des salles d’attente bondées de voyageurs faisant l’objet d’une enquête administrative plus poussée.
On nous a dit d’appuyer sur un bouton. Vert, tu passes. Rouge, on vide ton sac par le menu. Dehors, la nuit était tombée et nous sommes montées à bord d’un taxi sans en vérifier la provenance ni la plaque. Nous avons regardé l’orage éclater sur la périphérie de Tapachula et j’ai songé que les Mexicains avaient su faire preuve de pragmatisme jusque dans leur processus de fouille. A l’image de la vie, une loterie arbitraire et abjecte.